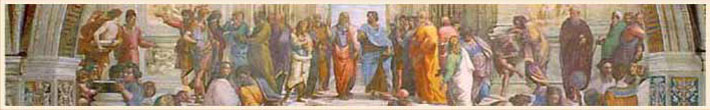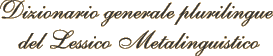| Citazioni |
 |
[...] ce qui distingue la synecdoque de la métonymie, c’est I°. Que la synecdoque fait entendre le ‘plus’ par un mot qui, dans le sens propre, signifie le ‘moins’, ou au contraire elle fait entendre le ‘moins’ par un mot, qui, dans le sens propre, marque le ‘plus’. 2°. Dans l’une et dans l’autre figure, il y a une relation entre l’objet dont on veut parler, et celui dont ou emprunte le nom; car s’il n’y avoit point de raport entre ces objets, il n’y auroit aucune idée accessoire, et par conséquent point de trope: mais la relation qu’il y a entre les objets, dans la métonymie, est de telle sorte, que l’objet dont on emprunte le nom, subsiste indépendament de celui dont il réveille l’idée, et ne forme point un ensemble avec lui. Tel est le raport qui se trouve entre la ‘cause’ et l’‘éfet’ [...] entre le ‘contenant’ et le ‘contenu’ [...] la liaison qui se trouve entre les objets dans la synecdoque, supose que ces objets forment un ensemble come le ‘tout’ et la ‘partie’; leur union n’est point un simple raport, elle est plus intérieure et plus indépendante: c’est ce qu’on peut remarquer dans les exemples de l’une et de l’autre de ces figures.
- Du Marsais (1971c), a pag.101 C’est le signe pour la chose signifiée: c’est une metonymie.
- Du Marsais (1971c), a pag.27 La métonymie et la synecdoque, aussi bien que les figures qui ne sont que des espèces de l’une ou de l’autre, sont fondées sur quelque autre sorte de raport qui n’est ni un raport de ressemblance, ni un raport du contraire. Tel est, par exemple, le raport de la cause à l’éfet; ainsi, dans la métonymie et dans la synecdoque, les objets ne sont considérés ni come semblables, ni come contraires; on les regarde seulement come ayant entr’eux quelque relation, quelque liaison, quelque sorte d’union; mais il y a cette diférence, que, dans la métonymie, l’union n’empêche pas qu’une chose ne subsiste indépendanment d’une autre; au lieu que, dans la synecdoque, les objets dont l’un est dit pour l’autre, ont une liaison plus dépendante [...] l’un est compris sous le nom de l’autre, ils forment un ensemble, un tout [...] Enfin dans la synecdoque il y a plus d’union et de dépendance entre les objets dont le nom de l’un se met pour le nom de l’autre, qu’il n’y en a dans la métonymie.
- Du Marsais (1971c), a pag.184-185 Le mot de ‘métonymie’ signifie transposition, ou changement de nom, un nom pour un autre. En ce sens, cette figure comprend tous les autres tropes; car dans tous les tropes, un mot n’étant pas pris dans le sens qui lui est propre, il réveille une idée qui pouroit être exprimée par un autre mot.
- Du Marsais (1971c), a pag.66 Les maîtres de l’artrestraignent la métonymie aux usages suivans. I°. LA CAUSE POUR L’EFET [...] 2°. L’ÉFET POUR LA CAUSE [...] 3°. LE CONTENANT POUR LE CONTENU [...] 4°. LE NOM DU LIEU, où une chose se fait, se prend POUR LA CHOSE MESME [...] 5°. LE SIGNE POUR LA CHOSE SIGNIFIÉE [...] 6°. LE NOM ABSTRAIT POUR LE CONCRET [...] 7°. Les parties du corps qui sont regardées come le siège des passions et des sentimens intérieurs, se prènent pour les sentimens mêmes [...] Voilà les principales espèces de métonymie.
- Du Marsais (1971c), a pag.66-83
|